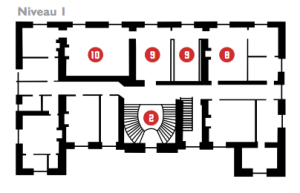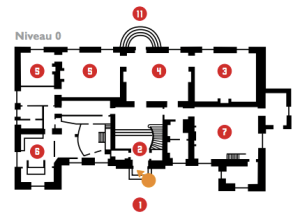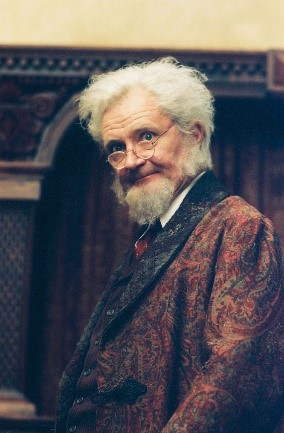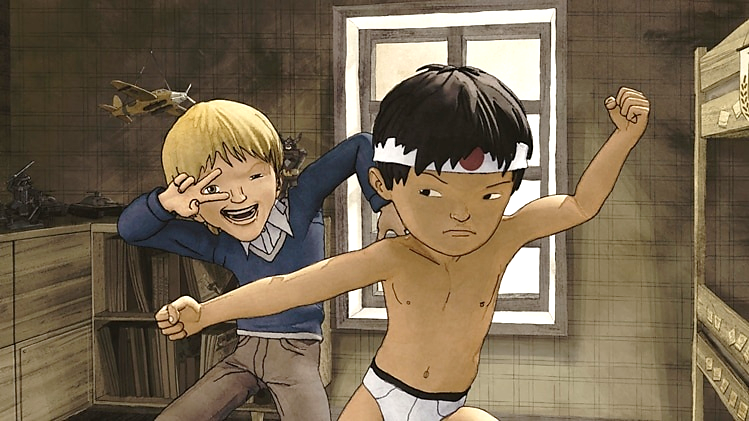Sophie SOCCARD
Le Mans Université, Laboratoire 3.LAM Angers-Le Mans
Mary Astell aimait les métaphores végétales pour éclairer ses positions. L’anglaise érudite fut l’une des premières femmes à stigmatiser les théories justifiant le nécessaire assujettissement des femmes sur le plan juridique notamment. Si elle comparait volontiers l’éducation au jardinage, c’est parce que, selon elle, les femmes, tout comme les hommes, sont des créatures qui ne doivent leur épanouissement qu’aux soins qu’on leur prodigue. Dans son essai paru en 1694 et intitulé A Serious Proposal to the Ladies, Mary Astell dénonce la passivité de ses sœurs qui se sont laissées enfermées, involontairement peut-être, dans un rôle décoratif : « Comment pouvez-vous vous contenter d’être un simple ornement pour le monde telles des tulipes, jolies, mais bonnes à rien [1]? » Avec ce reproche qui frôle la remontrance, l’intellectuelle met les femmes au défi de renverser la tradition qui les confine au monde de l’apparence. Selon Astell, les femmes ne sont pas seulement victimes mais aussi responsables, sinon coupables de leur condition croyant tirer avantage de leur frivolité et insouciance. La femme de lettres cherche ainsi à éveiller la conscience de ses semblables, prises dans l’étau d’un conditionnement patriarcal qui les asservit sur le plan socio-économique et qui les entrave sur le plan intellectuel. En ce XVIIe siècle finissant, Astell fait de la lutte contre l’exclusion des femmes du monde du savoir son cheval de bataille. Sa tâche est lourde et justifiée et pour rendre brièvement compte de l’état des lieux de l’éducation des filles dans l’Angleterre du XVIIe siècle, il est sans doute nécessaire de faire la part entre les usages et les discours qui ont façonné cette phase de l’histoire.
Le terrain éducatif dont l’immobilisme est dénoncé par Mary Astell a pourtant vu ses fondations trembler dès le début du XVIe siècle avec deux courants de pensée essentiels : d’une part avec certains des principes édictés par Luther vers 1517 favorisant l’accès des femmes à la culture, d’autre part avec l’héritage manifeste et prestigieux des penseurs humanistes. En 1523, le philosophe espagnol Jean-Louis Vivès est invité à la cour anglaise d’Henri VIII par sa royale épouse, Catherine d’Aragon. Dès son arrivée, Vivès dédie à la reine un traité pédagogique complet qui préconise de moduler les exigences normatives de son époque en proposant aux filles et aux femmes une éducation intellectuelle plus exigeante. Catherine d’Aragon le charge de l’éducation de leur fille, la petite Marie Tudor[2]. L’Humaniste anglais Roger Asham est le précepteur de la future Élisabeth I ainsi que de sa cousine qui devint la très lettrée Marie Stuart. Un peu plus tard, l’encyclopédiste de Cambridge, dont le célèbre The Shoolmaster fut publié de manière posthume en 1570, signe l’ébauche d’une pédagogie moderne en recommandant la traduction systématique en anglais vernaculaire de toutes les œuvres rédigées en latin[3]. D’une manière plus générale, son traité est un plaidoyer en faveur de la douceur et de la persuasion et déplore toute coercition en matière pédagogique.
Un siècle et demi avant Fénelon et son fameux traité sur l’éducation des filles[4], soixante ans avant Montaigne, Sir Thomas More, savant humaniste et Chancelier du royaume d’Angleterre (1478-1535) souligne lui aussi la nécessaire diffusion du savoir dans les esprits féminins. Il écrit à son ami Érasme :
Si une femme parvient à joindre à d’éminentes vertus naturelles une instruction, même modeste, je la considèrerai comme s’étant davantage approchée du véritable bien que si elle réunissait à la beauté d’Hélène les richesses de Crésus[5].
À l’occasion d’un séjour chez More en 1509, Érasme découvre un modèle d’éducation féminine bien différent de celui que l’on propose aux Pays-Bas, et plus largement, en Europe. Dans son manoir de Chelsea, le long des berges de la Tamise, Thomas More apprend à sa femme, à son fils et à ses trois filles à lire des œuvres classiques en latin, parfois même en grec et il intègre aussi à son enseignement de nombreux ouvrages philosophiques et théologiques. Les filles de More écrivent en latin et discutent souvent dans cette langue. More ne fait aucune distinction entre les sexes. Ses enfants étudient ensemble les arts libéraux et les langues anciennes tout en approfondissant leur piété. Cet apprentissage peu commun se fait dans une atmosphère d’amour et de douceur, entrecoupé par des chants accompagnés de divers instruments. More avoue à son ami qu’il ne pourrait châtier ses filles, ne serait-ce qu’avec une plume du paon. Érasme est impressionné par la qualité des compositions latines de jeunes filles, rédigées sans aide et dans une langue irréprochable. Il compare les filles de More aux trois Grâces et l’école domestique de son ami à l’Académie de Platon[6].
L’idée d’une éducation classique pour les filles, et désormais intellectuellement plus ambitieuse, fait son chemin et dépasse le seul but religieux auquel elle a longtemps été assignée. L’autorité et la qualité de la pensée des humanistes inspirent la période élisabéthaine, mais ses principes doivent composer avec les apports d’un nouveau courant intellectuel, celui des réformateurs. En effet, avec les progrès de la Réforme protestante portée par Luther, se développe dans l’Europe du Nord l’idéal d’une société radicalement appuyée sur l’enseignement des Écritures. Luther avait souhaité multiplier les écoles pour tous, en partie pour pérenniser les effets de sa conquête religieuse. C’est aussi cette aspiration qui l’a rendu favorable à un enseignement délivré par les femmes, piliers du foyer. Les puritains placent la connaissance de la doctrine au cœur du salut des hommes car « comment pourront-ils connaître la volonté de Dieu s’ils ne peuvent la lire ? » écrit le prélat non conformiste, George Swinnock dans The Christian Man’s Calling (1663). Les puritains forment de nombreux enseignants et contribuent à la dissémination d’un nouveau modèle de cellule familiale au sein de laquelle la femme est davantage partenaire active que compagne soumise. La pratique cultuelle, adossée à la lecture des Écritures au sein du foyer, développe l’alphabétisation des filles appelées à devenir mères. Ce nouveau paradigme vise donc à permettre aux femmes, toutes classes confondues, de savoir lire et écrire, voire de les rendre suffisamment compétentes pour dispenser un enseignement religieux non seulement à leurs propres enfants mais aussi aux domestiques de la maisonnée. Ce phénomène n’a pas été sans porter préjudice à la qualité de l’éducation prodiguée aux filles de haut rang, car, avec lui, l’idéal aristocratique élisabéthain s’éclipse au profit d’une pratique plus collective.
Dans l’Angleterre d’Élisabeth cependant, la question de l’éducation féminine soulève des divergences substantielles ; un certain John Knox s’y oppose avec une misogynie notoire dans son véhément pamphlet intitulé : The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women, en 1558. Ses propos outrageants invalident l’autorité des femmes accusées d’être des créatures non seulement faibles, mais aussi aliénées, enragées, voire difformes[7]. Ses nombreux détracteurs, masculins et féminins, continuent cependant de prôner l’accès à l’école pour les garçons comme pour les filles. Remède à l’oisiveté et au vagabondage, l’école enseigne le respect de l’ordre, lutte contre la rébellion, écarte potentiellement la pauvreté. Une prise de conscience des soulèvements populaires latents parle en faveur des institutions scolaires. De toute évidence, le fait qu’un monarque fût femme, laquelle érudition était notoire, décide de l’avancée de l’éducation pour les filles. Au cours du règne d’Élisabeth I, le pédagogue Richard Mulcaster[8] publie un traité pour l’éducation intitulé Positions dont l’un des chapitres est entièrement dédié à l’éducation féminine. Il y implore, non sans emphase, la nécessité d’éduquer les filles : « Notre pays le permet, notre devoir l’impose ; leur compétence l’exige ; leur grandeur le commande. »[9] À cela s’ajoute l’enjeu confessionnel essentiel pour l’Église anglicane qui cherche à s’enraciner. L’alphabétisation et la catéchisation deviennent les outils du contrôle de la pratique religieuse. Comme il n’existe aucun système scolaire centralisé, la création des écoles reste tributaire des autorités locales qui n’ont pas toujours les moyens de leurs ambitions. Les petty schools et les ABC schools qui dispensent des connaissances élémentaires, auxquelles succèdent les grammar schools, collèges d’humanités qui prodiguent les premiers enseignements en latin, s’établissent donc de manière aléatoire dans le royaume mais leur progression est avérée au début du XVIIe siècle, particulièrement dans les villes marchandes du territoire rural. [10]
Lorsque des écoles leur sont accessibles, les filles de condition très modeste apprennent à lire mais moins à écrire. Comme l’affirme Caroline Bowden, « l’éducation dispensée dans les familles dépendait du sexe des enfants, les filles recevant moins d’instruction que les garçons dans certains cas[11]. » L’apprentissage de l’écriture étant onéreux, les parents sont peu disposés à procurer aux filles le matériel nécessaire à l’écriture, surtout le très coûteux papier chiffon dont l’Angleterre n’allait pas tarder à connaitre la pénurie vers la fin du XVIIe siècle[12]. D’ailleurs, les registres paroissiaux ou les contrats de mariage révèlent que les signatures des femmes sont moins bien formées que celles des hommes. Priorité est donnée à l’apprentissage de la lecture qui s’effectue à partir de la Bible, des psaumes et autres versets de dévotion, saturés d’exemples de comportements féminins vertueux. Les chiffres de l’alphabétisation démontrent un retard évident des filles par rapport aux garçons[13]. En effet, les institutions scolaires sont d’une façon générale destinées aux garçons car il était de mise de considérer que les mères suffisaient à pourvoir à l’inéluctable vocation domestique de leurs filles. Leurs futurs statuts d’épouse, de mère et de maîtresse de maison dictent le contenu de leur formation sommaire. Même si dans les classes plus populaires le mariage tardif, pratiqué en France tout comme en Angleterre, amène les filles à travailler hors de chez elles pendant leurs années de célibat, cette période d’autonomie ne constitue qu’une brève étape dans leur vie et ne permet jamais d’aboutir à la pratique d’un métier véritable. Ainsi, bien que les filles soient de plus en plus nombreuses à fréquenter les écoles, parfois même des institutions spécialement fondées pour elles, leur rôle traditionnel en tant que femme adulte n’évolue pas dans la société anglaise de la première modernité.
Dans les familles suffisamment aisées pour s’offrir les services d’un précepteur, l’éducation s’y trouve également genrée. En effet, les jeunes femmes de haute condition demeurent confinées à un enseignement spécifique, destiné à faire d’elles des compagnes captivantes pour leurs futurs conjoints ; on leur enseigne les langues étrangères, particulièrement le français, mais l’apprentissage du latin ou du grec leur reste interdit. On leur préfère de réputés nécessaires mais chronophages travaux d’aiguille et, pour les plus favorisées, l’enseignement des arts d’agrément comme le chant ou le piano. Dans certaines familles aristocratiques toutefois, certains paramètres justifient la nécessité d’éduquer davantage les filles. Les enjeux économiques prennent alors le pas sur les considérations genrées lorsqu’il s’avère que savoir gérer un domaine peut favoriser une union avantageuse. Contre toute attente, la société reste profondément convaincue qu’une femme cultivée ne constitue pas un parti privilégié, préjugé que Bathsua Makin commence à combattre[14].
1. Dorothy Moore et Katherine Ranelagh au secours des jeunes anglaises
Dans l’Angleterre caroléenne, les jeunes anglaises se trouvent donc dans une situation globalement défavorable. Dans les rangs féminins lettrés, des voix s’élèvent pour dénoncer cette situation et prôner les valeurs humanistes défendues un siècle plus tôt. Parmi elles, deux femmes unies par les mêmes idéaux bien qu’issues de milieux fort différents. Les propositions qui suivent proviennent d’une lecture minutieuse de leur échange épistolaire, mais aussi des lettres adressées à Samuel Hartlib et aux membres de son cercle éponyme. L’analyse qui en découle se fonde notamment sur la construction de certaines hypothèses car ces lettres ne nous sont pas toutes parvenues dans leur intégralité ; S’ouvre donc ici un champ de suggestions rationnelles, à l’image de ce que Dorothy Moore et Katherine Ranelagh ont construit dans un rapport aussi singulier qu’exceptionnel.
Dans cet échange, conservé dans les Hartlib Papers déposés à l’université de Sheffield[15], on trouve un traité rédigé par Dorothy Moore. Fille d’un colon anglais modeste établi en Irlande, Dorothy y déplore le peu d’éducation concédé aux femmes issues de familles de bonne condition et évoque sa propre scolarité qui ne l’a instruite que de rudiments inutiles, « la danse » et de « curieux travaux », faisant référence aux travaux d’aiguille qui n’ont servi selon elle qu’« à remplir la fantaisie d’une imagination inutile, peu rentable et orgueilleuse[16]. » Elle se lamente de n’avoir été préparée à rien d’autre qu’à cuisiner, tenir son foyer et danser. Des regrets étonnants puisqu’ayant acquis la maîtrise du grec et de l’hébreu, elle a pu livrer de doctes commentaires en matière de religion.[17] Par conséquent, sa déception soulève la question suivante : si son éducation était déficiente, comment a-t-elle pu devenir érudite[18] ? Le père de Katherine Jones ne voit lui aussi aucun intérêt à l’éducation de sa fille, si ce n’est de la préparer de manière assez rudimentaire à son mariage. Le destin académique de Katherine est pourtant bien différent car la jeune femme reçoit le privilège d’être à la fois instruite par l’aumônier de la famille et par les précepteurs de ses frères, dont le futur et éminent scientifique Robert Boyle. Les capacités intellectuelles exceptionnelles de Katherine sont d’ailleurs très tôt remarquées par l’entourage masculin de son père, comme en témoignent certains courriers[19]. Voilà donc deux jeunes femmes issues de milieux fort éloignés, néanmoins unies par des dispositions intellectuelles prodigieuses, engagées dans une discussion épistolaire stratégiquement discrète mais éminemment vigoureuse et constructive.
« Femme bavarde ne saurait être chaste »[20], telle est la mise en garde d’un proverbe datant de la Renaissance mais étrangement au goût du jour : réputées enfreindre les règles de la morale, les femmes instruites sont considérées comme sexuellement déviantes. On dit alors d’une femme qui piétine les interdits qu’elle « souille son âme de vice et d’abominations immondes[21]. » Même un humaniste comme Jean-Louis Vivès, connu pour ses positions favorables à l’éducation féminine, condamne les femmes qui s’aventurent à l’étude des belles lettres[22]. Seule une existence de réclusion, dans l’obscure quiétude d’un couvent, peut offrir un cadre convenable à une vie consacrée à l’étude en soustrayant ladite femme de la vie publique. À une époque où les femmes doivent garder le silence, Katherine Jones et Dorothy Moore réussissent un tour de force : faire entendre leur voix tout en sauvegardant leur vertu morale. En s’introduisant dans les cercles influents, elles vont nourrir une correspondance qui permet de diffuser leurs idées sans jamais sortir des limites imposées par la société. Admises au sein d’un réseau qui réunit la fine fleur de la République des lettres, Dorothy Moore et Katherine Jones ont conquis les grâces de la savante poétesse des Pays-Bas, Anna Maria von Schurmann (1607-78) qui fut l’instigatrice et le pivot de l’institution. En s’affiliant à un groupe dont les femmes savantes ne sont pas exclues, ces érudites pénètrent ainsi dans une « vaste communauté composée d’hommes mais aussi de quelques femmes partageant tous le même goût pour l’étude[23]. » Même s’il leur demeure impossible de participer à la vie des académies ou encore d’exercer une quelconque profession intellectuelle, des femmes, dans l’Europe du milieu du XVIIe siècle, participent et enrichissent de savants échanges en matière de philosophie, de religion ou d’éducation.
En raison de son rang social, Katherine Jones est impliquée dans de nombreux cercles, dont ceux qui devaient construire la Royal Society, le Great Tew, l’Invisible College, et encore le cercle des amis d’Hartlib dont il est particulièrement question ici. A l’image de la très symbolique figure géométrique qui les contiennent, ces cercles intellectuels tissent un large éventail d’interactions sociales, liant des correspondants, hommes et femmes, qui, bien qu’éloignés sur le plan géographique ou socio-économique, nourrissent des intérêts intellectuels communs. Lorsque Katherine Jones arrive à Londres en 1642, sa tante Dorothy Moore lui présente Samuel Hartlib. Ce dernier suggère d’utiliser l’adresse de Katherine Jones, désormais devenue Lady Ranelagh, comme référence eût égard à sa notoriété. Très vite sa maison devient aussi un lieu de rencontres où des personnes d’horizons politiques et religieux éclectiques échangent autour de thématiques intellectuelles variées[24]. Le cercle Hartlib commence à acquérir une réputation internationale d’hommes et de femmes érudits[25]. Liés par un engagement commun cristallisé autour du projet de Comenius, ils travaillent tous à une sorte de réforme universelle grâce à un large éventail de projets disparates qui va de l’amélioration de l’agriculture à la réunification de la chrétienté, en passant par une véritable révolution dans l’éducation. Hartlib, Comenius et Dury forment le noyau dur de ces réformateurs unis par un pacte grâce auquel ils ont promis de consacrer leur vie, « à la gloire de Dieu et à l’utilité publique », élan humaniste qui n’est pas étranger aux idéaux puritains visant à transformer l’Angleterre en une société pieuse[26].
Le projet consiste à donner un large accès à toutes les connaissances initialement rassemblées par Hartlib et ses clercs. L’objectif ainsi défini constitue la condition préalable à la réalisation de la Nouvelle Atlantide, la société utopique de Bacon. L’idéal de libre communication des connaissances est au cœur de tous les projets du cercle Hartlib et la rhétorique de « l’ouverture contre le secret » imprègne l’esprit des lettres philosophiques rédigées par des membres du cercle Hartlib et par Lady Ranelagh elle-même. Cette dernière contribue à la formation de cette « mémoire » collective en partageant les remèdes et thérapies réputés efficaces. Nombre de ces informations ont été rassemblées dans les journaux d’Hartlib, « Les éphémérides », qui forment une extension singulière au vaste travail scientifique et philosophique du cercle. Bien qu’à cette époque les femmes ne soient pas autorisées à devenir médecins, elles sont responsables de la santé de leur foyer. Ce qu’elles connaissent du corps humain reste dans le domaine de la transmission orale puisqu’on leur refuse l’éducation nécessaire à la transmission écrite. Recettes culinaires et pratiques thérapeutiques sont pourtant consignées dans des cahiers transmis de mère en fille. Aussi est-il tout à fait probable que certaines de ces autrices aient été spoliées de leurs connaissances, lesquelles ont pu être reprises et intégrées dans des ouvrages dont se réclamaient des soignants masculins[27].
2. Le projet Hartlib pour l’amélioration de l’éducation
Usant de stratégies détournées, Moore et Jones tentent de trouver un moyen de répondre à leurs propres attentes intellectuelles. Ces femmes enthousiastes à l’idée de participer à des découvertes scientifiques sont les pionnières d’une nouvelle conception de la science, c’est-à-dire un domaine débarrassé des a priori de genre. L’une des stratégies utilisées par ces femmes, et pas seulement par Moore et Jones, consiste à servir les objectifs de savants aristocrates qui traitent avec défiance l’étude de nouveaux sujets comme la chimie. En effet, les expériences menées dans ce domaine sont souvent considérées comme inappropriées à leur statut masculin, et donc propres à être reléguées aux petites mains féminines, dussent-elles être aristocratiques ; on entend : « the Lords are the Lords and the ladies are the commons »[28], jugement ô combien dépréciatif qui illustre le doute, sinon le mépris pour les femmes pensantes. Au cours des années 1640, Katherine Jones relève le défi et transforme sa cuisine en un laboratoire dans sa propre maison de Londres où elle exécute quelques expériences de chimie[29]. Saisissant le prétexte d’une activité typiquement féminine, la cuisine, l’aristocrate s’adonne à la préparation des herbes et distille des potions à la recherche de remèdes dont la maisonnée entière pourra bénéficier[30]. Son initiative témoigne de la capacité de certaines femmes à créer leurs propres opportunités éducatives qu’elles ne manquent d’ailleurs pas de partager avec d’autres femmes. De sorte que convertissant leur foyer en un espace de savoir, ces femmes transforment des lieux éloignés de l’école institutionnelle et initient un système qui s’apparente à notre formation continue[31].
Les échanges épistolaires entre Katherine Jones et Dorothy Moore aboutissent naturellement à la remise en cause de l’éducation des filles. Elles sont convaincues par l’approche coménienne de l’éducation qui constitue le cœur du cercle Hartlib. Inclure « la raison et l’intellect », tel est le principe qui doit présider à l’acquisition de compétences pratiques pour les garçons et les filles au sein d’un système qui réserve l’enseignement des sujets complexes à ceux et celles qui augurent d’un potentiel intellectuel prometteur[32]. Les actions de Katherine et Dorothy s’inscrivent dans le contexte plus général des bouleversements tumultueux en politique et en religion, qui, dans les années 1630-1660, se sont déroulés sur fond de l’approche empirique de Bacon propre à formuler de nouvelles interrogations. Elles ont toutes deux remis en question le rôle traditionnel de la femme tel que dicté par la société patriarcale. Pour Dorothy Moore, être mère n’est qu’une position subalterne et toute femme doit pouvoir s’épanouir par-delà les assignations sociétales[33]. Sa propre recherche d’un projet professionnel satisfaisant se heurte pourtant à de nombreuses incertitudes dont elle s’ouvre auprès de Katherine Jones. Dans l’une de ses lettres, elle souligne son souhait de prêcher la parole biblique, mais elle craint de ne pas avoir entendu assez distinctement l’appel de Dieu[34]. Elle découvre cependant qu’elle peut parfaitement s’impliquer dans l’œuvre divine en devenant enseignante, activité qui correspond à son propre engagement au sein du cercle Hartlib ainsi qu’au programme réformateur de ce dernier. C’est aussi ce qui incite Dorothy More à revendiquer l’accès au savoir théologique pour les femmes de toute classe, dénonçant ainsi l’exclusion dont ces dernières sont victimes en matière cultuelle. L’essentiel de sa correspondance, rédigée entre 1643 et 1645, se concentre sur ses efforts à assurer une place pour les femmes au sein du clergé. Jugea-t-elle ses avancées décevantes dans la pratique ? Au cours des années 1645-1650, elle modifie le sens de son implication et choisit de privilégier la mise en place des nouvelles pratiques pédagogiques à l’ordre du jour du cercle Hartlib.
Il est vrai que l’éducation reste au cœur des préoccupations de Dorothy Moore. Il figure notamment dans son échange épistolaire avec Anna Maria Von Schurmann. Ses lettres marquent une différence stylistique avec celle de sa destinataire et révèlent un contraste culturel symptomatique. Schurmann s’appuie sur les textes des penseurs de la Renaissance tels que Pic de la Mirandole. Moore, de son côté, fait appel aux sources bibliques de sorte que ses citations certifient ses connaissances théologiques et lui apportent le respect intellectuel qu’elle recherche. Toutes deux tiennent à défendre l’accès des femmes au savoir, mais Schurmann préconise l’étude des sciences comme moyen de développer l’égalité entre les hommes et les femmes[35]. Au moment-même de cet échange, John Milton aussi écrit sur l’éducation et prétend adhérer aux principes coméniens tels qu’une pédagogie procédant d’exemples sensibles pour mieux parvenir aux idées abstraites. C’est Hartlib qui publie son traité Of Education[36] dont l’idée directrice consiste en une formation aux humanités pour les étudiants masculins uniquement, issus de la « bonne » société qui plus est. Milton ne partage pas l’avis du réseau sur la nécessité d’étendre la réforme à l’éducation des filles. Son ami, John Dury, qui est aussi l’époux de Dorothy Moore, ne l’entend pas de la même oreille. Les lettres échangées sur ce point au sein du cercle laissent supposer que John Dury et son épouse Dorothy Moore ont établi conjointement un programme éducatif, probablement en réaction au traité de Milton si l’on s’en réfère à la chronologie des courriers. Tout comme son épouse, Dury souhaite entreprendre une réforme nationale des écoles. Sa préoccupation se limite cependant à l’éducation des élèves masculins, quelle que soit leur condition sociale, préconisant des écoles utiles à « toutes les sociétés d’hommes[37] ». Il existe toutefois une mention – une seule – où il indique que « les langues et les sciences […] ne sont pas à négliger » [38] au sens où elles pourraient aider les filles à améliorer leurs capacités intellectuelles.
Dorothy Moore enchérit en ce sens et encourage à la rédaction de directories, sortes de petits guides prodiguant des conseils à suivre heure par heure et portant la droiture morale au pinacle des vertus[39]. Sensible aux principes éthiques de Dorothy Moore, Katherine Jones lui suggère la rédaction d’un court traité favorable à l’éducation des filles[40]. Dans cet opuscule qui ressemble moins à un protocole pédagogique qu’à une longue lettre structurée à l’adresse de Lady Ranelagh, Dorothy Moore va ainsi s’opposer à l’enseignement des pratiques domestiques, car, selon elle : « elles n’apportent aucun bien à l’âme ou au corps de l’humanité : elles ne sont fondées ni sur la religion ni sur la raison ».[41] Katherine Jones, qui partage l’emphase de sa tante portée sur « la religion » ou « la raison » continue d’organiser en sa maison des réunions portant cette fois sur la réforme de l’éducation comme le prouve une lettre écrite à Hartlib mais dont on ne retrouve qu’un long extrait. Elle y explique : « J’attends en effet la réunion ici cet après-midi des deux philanthropes que vous mentionnez [Mr Wood et Mr Potter], de mon frère Boyle, ainsi que d’une autre personne sagace, afin de poursuivre ce travail[42]. » Katherine affirme en outre que l’éducation des enfants est essentielle pour « poser les fondations du Royaume du Christ », car « elles ne peuvent être établies non d’une manière rationnelle, mais par une bonne et opportune instruction, jointe à une discipline et à une direction qui peuvent habituer les enfants à répéter les bonnes leçons qu’on leur enseigne par l’obéissance et la conformité quotidiennes à celles-ci[43]. » Les annotations portées sur ce document indiquent clairement que Robert Wood, Robert Boyle, Francis ou William Potter, et « une autre personne sagace » furent présents à sa réunion. L’idée d’une éducation pour les filles à dominante morale, théologique et pour le moins sevrée des impératifs de la vie domestique poursuit son chemin. Bien que Katherine Jones n’ait pas été éducatrice elle-même, elle promeut l’éducation tout au long de sa carrière comme un outil majeur de changement. Elle avait engagé John Milton comme tuteur pour instruire deux membres de sa famille afin de donner une vie réelle à l’œuvre majeure de Francis Bacon Instauratio[44] dans laquelle le philosophe s’appuie sur l’idée d’un progrès continu que nul champ d’expérience ne doit borner.
3. Le progrès de l’apprentissage par le progrès de l’enseignement
Grâce à ses relations avec John Dury et Van Schurmann[45], Dorothy Moore espère participer à l’éducation des princesses royales, les filles de Charles II, lequel doit s’exiler de 1651 à 1661 dans les Provinces Unies après l’exécution de son père, le roi Charles Ier. La fonction de préceptrice permettrait à More de conserver la proximité géographique nécessaire à l’entretien de son réseau. Hélas, l’opposition trop évidente de son époux John Dury à la conduite politique de Charles Ier contrarie son projet[46]. S’il est nécessaire de souligner cet élément, c’est aussi pour montrer combien les femmes dépendent puissamment des paramètres conjugaux pour poursuivre une activité intellectuelle. Dépitée, Dorothy Moore retourne à ses préoccupations cultuelles et débute une correspondance régulière avec le théologien huguenot français, André Rivet. Au cœur de leur échange on retrouve la question du rôle des femmes au service de Dieu. Face au théologien pour qui les femmes n’étaient pas destinées à prêcher, Dorothy Moore soulève à nouveau une question complexe, voulant concilier l’égalitarisme théorique des âmes avec les restrictions imposées au corps féminin[47]. Son modèle alternatif s’appuie sur les injonctions de la conscience qui confinent à la vocation du ministère public. D’une certaine manière, Dorothy Moore anticipe, grâce à ses propositions, le débat sur l’idéologie du contrat social dont les femmes furent exclues. À un moment où la théologie radicale donne le pouvoir exclusivement aux hommes, elle doit donc trouver d’autres implications de l’action féminine au service du bien public[48]. « Pour nous autres femmes, je ne connais pas de moyen plus puissant que l’éducation pour aider la jeunesse à pénétrer dans le Royaume de Dieu et pour attribuer la responsabilité de ces avancées directement à notre sexe » écrit-elle à Katherine Jones[49]. Si l’action publique des femmes pouvait se développer par l’enseignement, l’exclusion des femmes des pratiques cultuelles s’en trouverait effectivement fortement ébranlée.
Contrairement à ce que l’on a longtemps pensé, les intellectuelles femmes ne furent pas systématiquement exclues des communautés érudites du XVIIe siècle[50]. Certaines d’entre elles leur étaient même particulièrement accueillantes. Il est vrai que si « l’incomparable Lady Ranelagh »[51], sobriquet récurrent pour la désigner, savait habilement entrebâiller les portes les plus hermétiques, ce sont ses origines sociales qui ont assuré un rôle déterminant[52]. Ces femmes, qui s’entraidaient activement dans la constitution de leurs réseaux, lisaient, commentaient et recommandaient des livres, traduisaient l’hébreu, le grec ou le latin en anglais ou en français, prenaient part à des débats sur des questions religieuses ou philosophiques controversées. Plus particulièrement, Dorothy Moore et Katherine Jones ont contribué au progrès de l’éducation pour les filles en privilégiant une approche empirique de l’apprentissage scientifique. Toutes deux furent pionnières en matière d’éducation moderne des filles, plaçant l’enfant au centre de leurs méthodes pédagogiques. Pourtant, se souvient-on d’elles ? En 1661, la mort d’Hartlib a mis un terme à leurs projets d’envergure. Dépourvues d’affiliation institutionnelle, ses collaboratrices ont dû cesser leurs activités en l’absence d’une référence masculine propre à légitimer le fondement de leurs avancées théoriques.
Souffrant de difficultés financières et de problèmes de santé, Dorothy Moore n’avait plus guère d’énergie pour écrire. Elle fit tout de même usage de ses relations pour aider son mari devenu exilé politique aux Pays-Bas, lequel continuait à voyager dans les cours protestantes d’Europe afin de poursuivre son rêve d’unification de l’Église. Katherine Jones, quant à elle, resta active car elle a pu développer d’autres réseaux. Grâce à son frère, le fameux Robert Boyle, devenu membre de la Royal Society, elle a pu rester en lien avec d’assez nombreux cercles scientifiques et recevait le soutien de ses correspondants masculins. Pourtant, l’impossibilité d’atteindre un public plus large continuait à restreindre les limites du savoir féminin prescrit. À la fin du XVIIe siècle, c’est donc Mary Astell qui évalua à nouveau les aspirations des érudites et de celles qui pourraient le devenir, dussent-elles abandonner leurs activités frivoles. Son puissant pamphlet féministe et son intérêt pour l’éducation des femmes démontrèrent qu’une ambition à constituer une communauté savante féminine n’avait pas disparu[53]. Leur présence dans les universités, toujours rare et exceptionnelle, reste un indicateur puissant de la difficulté d’associer les femmes aux institutions du savoir. Encore aujourd’hui, les érudites de cette époque restent dans les mémoires au titre qu’elles furent filles, sœurs ou épouses d’un savant célèbre. Trois siècles après la rencontre féconde entre Katherine Jones et Dorothy Moore, une autre femme instruite, au cœur d’un cercle intellectuel très estimé, le Bloomsbury Group, soupire : « Ce que je déplore […] en parcourant à nouveau les étagères, c’est que l’on ne sait rien des femmes avant le XVIIIe siècle. Je n’ai pas de modèle dans mon esprit pour tourner dans un sens ou dans l’autre. » Virginia Woolf dans Une chambre à soi fut l’une des premières à soulever la question de l’invisibilité de ses consœurs[54].
Bibliographie :
Sources Primaires
ASHAM, Roger, The scholemaster or plaine and perfite way of teachyng children, to vnderstand, write, and speake, the Latin tong, Londres, 1570.
ASTELL, Mary, A Serious Proposal to the Ladies for the Advancement of their True and Greatest Interest. Parts I and II, 1694, 1697, Patricia Springborg (dir.), Londres, Pickering, 1997.
ASTELL, Mary, Reflections Upon Marriage, Londres, John Nutt, 1700.
DURY, John, The Reformed School, Londres, [1649?], <http://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A37084.0001.001>, [consulté le 28 septembre 2023]
FÉNELON, François de Salignac de la Mothe, De l’Éducation des filles, Paris, P. Aubouin, 1687.
GREY, Elizabeth, A choice manual of rare and select secrets in physick and chyrurgery collected and practised by the Right Honorable, the Countesse of Kent, late deceased; as also most exquisite ways of preserving, conserving, candying, &c., Londres, G. D.,1653.
KNOX, John, The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women, Londres, 1558.
MAKIN, Bathsua, An Essay to Revive the Antient Education of Gentlewomen in Religion, Manners, Arts and Tongues, Londres, J. D.,1673.
MILTON, John, Of Education, Londres, 1644. < https://www.dhi.ac.uk/hartlib/view?docset=pamphlets&docname=pam_14> [consulté le 24 Aout 2023]
MORE, Dorothy, The Letters of Dorothy Moore, 1612-64: The Friendships, Marriage, and Intellectual Life of a Seventeenth-century Woman, Lynette Hunter (dir.), Farnham, Ashgate, 2004.
MORE, Thomas, The Correspondence of Sir Thomas More, in Elizabeth, Frances Rogers (dir.), Princeton, Princeton University Press, 1947.
NOGAROLA, Isotta, Complete Writings: Letterbook, Dialogue on Adam and Eve, Orations, Margaret L. King et Diana Robin (trad.), Chicago, Chicago University Press, 2004.
VERNEY, Frances et VERNEY Margaret, Memoirs of the Verney Family, 3 vol., Londres, 1925, I, <https://archive.org/details/memoirsofverney01vern/page/122/mode/2up?q=memory> [consulté le 22 aout 2022]
TALBOT, Aletheia, Natura Exenterata: Or Nature Unbowelled By the most Exquisite Anatomizers of Her. Wherein are contained, her choicest Secrets digested into Receipts, fitted for the Cure of all sorts of Infirmities, whether Internal or External, Acute or Chronical, that are incident to the Body of Man. Collected and preserved by several Persons of Quality and great Experience in the Art of Medicine, whose names are prefixed to the Book, Londres, H. Twiford, G. Bedell et N. Ekins, 1655.
VIVÈS, Jean-Louis, L’éducation de la femme chrétienne, Pierre de Changy (trad.), 2010, Paris, L’Harmattan.
WOOLF, Virginia, A Room of One’s Own, Richmond, Hogarth Press, 1929.
Sources Secondaires
Sheffield University, The Hartlib Papers, < https://www.dhi.ac.uk/hartlib/>
BOTS, Hans, WAQUET, Françoise, La République des Lettres, Paris, Belin, Bruxelles, De Boek, 1997.
BOWDEN, Caroline, « Women in educational spaces », in L. Lunger Knoppers (dir.), The Cambridge Companion to Early Modern Women’s Writing, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 85-96.
CRAWFORD, Patricia, GOWING Laura, (dir.), Women’s Worlds in Seventeenth-Century England, London, Routledge, 2000.
CRESSY, David, Literacy and the Social Order, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.
DeMOLEN, Richard L. (dir.), Richard Mulcaster’s Positions, Classics in Education, N° 44, New-York, Teachers College Press, 1971.
GREENGRASS, Mark, « Archive Refractions: Hartlib’s Papers and the Workings of an Intelligencer », in Michael Hunter (dir.), Archives of the Scientific Revolution: The Formation and Exchange of Ideas in Seventeenth-Century Europe, Martlesham, Boydell Press, 1998, p. 35-48.
HILL, Christopher, Milton and the English Revolution, Londres, Faber and Faber, 1977.
HUNTER, Lynette, « Civic Rhetoric in England, 1560-1630 », in Ames Lewis (dir.), Sir Thomas Gresham and Gresham College, Aldershot, Ashgate publishing, 1999, p. 88-105.
HUNTER, Lynette, « Sisters of the Royal Society: The Circle of Katherine Jones, Lady Ranelagh », in Lynette Hunter et Sarah Hutton (dir.), Women, Science, Medicine, 1500-1700, Mothers and Sisters of the Royal Society, Stroud, Sutton Publishing, 1997, p. 178-197.
KING, Margaret L., «Book-Lined Cells: Women and Humanism in the Early Italian Renaissance», in Patricia Labalme (dir.), Beyond their Sex: Learned Women of the European Past, New York, New York University Press, 1980, p. 66-90.
MALHERBE, Michel, « Novum Organum (F. Bacon) », Encyclopædia Universalis, < http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/novum-organum-f-bacon/> [consulté le 11 novembre 2023]
O’DAY Rosemary, Education and Society, 1500-1800, The Social Foundations of Education in Early Modern Britain, New-York, Longman, 1982.
PAL, Carol, « Accidental Archives: Samuel Hartlib and the Afterlife of Female Scholars » in Vera Keller, in Anne Marie Roos et Elizabeth Yale (dir.), Archival Afterlives, Life, Death and knowledge-Making in Early Modern British Scientific and Medical Archives, Leiden, Brill, 2018, p. 120-149.
PAL, Carol, Republic of Women, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
PHILLIPS, Patricia, The Scientific Lady : a social history of women’s scientific interests 1520-1918, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1990.
PITASSI, Maria-Cristina, « Un Ministère ecclésial pour les femmes ? Le contexte culturel et théologique d’un échange épistolaire entre Dorothy Moore et André Rivet (1643) », in Dix-Septième Siècle, Presses Universitaires de France, 2021/4, n°293, Presses Universitaires de France, p. 337-349.
VAN ECK, Caroline, « The First Dutch Feminist Track? », in Miriam de Baar and al. (dir.), Choosing the Better Part, Anna Maria van Schurman (1607–1678), New-York, Springer, 1996, p. 43-54.
[1] « How can you be content to be in the World like Tulips in a Garden, to make a fine show, and be good for nothing. » Mary ASTELL, A Serious Proposal to the Ladies for the Advancement of their True and Greatest Interest. Parts I and II, 1694, 1697, Patricia Springborg (dir.), Londres, Pickering, 1997, p. 9. Ma traduction.
[2] Juan Luis VIVES, L’éducation de la femme chrétienne, Pierre de Changy (trad.), 2010, Paris, L’Harmattan.
[3] Roger ASCHAM, The scholemaster or plaine and perfite way of teachyng children, to vnderstand, write, and speake, the Latin tong, London, 1570.
[4] Le précepteur de Louis de France commence son traité avec cette fameuse assertion : « Rien n’est plus négligé que l’éducation des filles ». Il y considère que les filles doivent fortifier leur esprit avec des connaissances approfondies en religion, sans que cela ne les dédouane de l’apprentissage nécessaire à la bonne tenue d’une maison, François de Salignac de la Mothe FÉNELON De l’Éducation des filles, Paris, P. Aubouin, 1687, chapitre I, p. 1.
[5] Thomas MORE The Correspondence of Sir Thomas More, in Elizabeth, Frances ROGERS (dir.), Princeton, Princeton University Press, 1947, ma traduction.
[6] Margaret, la fille aînée du Chancelier, nourrit une correspondance avec Érasme et traduit l’un de ses ouvrages en anglais à l’âge de dix-neuf ans.
[7] « And first, where I affirm the empire of a woman to be a thing repugnant to nature, I mean not only that God, by the order of his creation, hath spoiled woman of authority and dominion, but also that man hath seen, proved, and pronounced just causes why that it so should be. Man, I say, in many other cases blind, doth in this behalf see very clearly. For the causes are so manifest, that they cannot be hid. For who can deny but it is repugnant to nature, that the blind shall be appointed to lead and conduct such as do see? That the weak, the sick, and impotent persons shall nourish and keep the whole and strong? And finally, that the foolish, mad, and frenetic shall govern the discreet, and give counsel to such as be sober of mind? And such be all women, compared unto man in bearing of authority. For their sight in civil regiment is but blindness; their strength, weakness; their counsel, foolishness; and judgment, frenzy, if it be rightly considered. » John KNOX, The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women, Londres, 1558, p. 6, < https://www.exclassics.com/blasts/reg.pdf> [consulté le 20 février 2024]
[8] Richard Mulcaster, (1531-1611) fut enseignant dans la célèbre Merchant Taylor’s School de Londres, puis dans celle de Saint Paul.
[9] «Our country doth allow it, our duty doth enforce it; their aptness calls for it; their excellency commands it. », Richard L. DEMOLEN (ed.), Richard Mulcaster’s Positions, Classics in Education, N° 44, New-York, Teachers College Press, 1971, p. 125-126.
[10] Rosemary O’DAY, Education and Society, 1500-1800, The Social Foundations of Education in Early Modern Britain, New-York, Longman, 1982, p. 27 à 31.
[11] « Provision of education in families was gendered, with girls receiving less education than boys in some cases. » Caroline BOWDEN, Women in educational spaces, in L. Lunger KNOPPERS (ed.), The Cambridge Companion to Early Modern Women’s Writing, Cambridge, C.U.P., 2009, p. 90.
[12] L’augmentation des tirages sur papier chiffe a entrainé une pénurie de chiffons et le papier devient alors très couteux. Il faudra attendre l’invention du papier vélin, mis au point en Angleterre en 1750. D’un grain soyeux et régulier, il fut d’abord réservé à des tirages de luxe.
[13] David CRESSY, Literacy and the Social Order, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, p. 145.
[14] Eduquée par Comenius, Bathsua Makin plaide en faveur des femmes: « Had God intended women only as a sort of cattle, he would not have made them reasonable. » Bathsua MAKIN, An Essay to Revive the Antient Education of Gentlewomen in Religion, Manners, Arts and Tongues, Londres, J. D., 1673. < https://digital.library.upenn.edu/women/makin/education/education.html> [consulté le 13 février 2024]
[15] The Hartlib Papers, < https://www.dhi.ac.uk/hartlib/> [consulté le 26 février 2023]
[16] Dorothy Moore à Katherine Jones, lettre non datée, [c. 1650], letter 52, Dorothy MORE, The Letters of Dorothy Moore, 1612-64: The Friendships, Marriage, and Intellectual Life of a Seventeenth-century Woman, Lynette Hunter (dir.), Farnham, Ashgate, 2004, p. 20.
[17] Dorothy Moore à André Rivet, lettre du 23 septembre 1643, lettre 11, Ibid. p. 21.
[18] Dury et Hartlib l’évoquaient souvent sous le nom de « Miss Aethiop ». Voir Carol PAL, «Accidental Archives: Samuel Hartlib and the Afterlife of Female Scholars» in Keller, V., Roos, A. M., Yale, E., Archival Afterlives, Life, Death and knowledge-Making in Early Modern British Scientific and Medical Archives, Brill, 2018, chapter 3, p. 120-149.
[19] Les talents singuliers de Katherine Jones furent remarqués dès son plus jeune âge. En 1638, Sir John Leeke, après l’avoir rencontrée, la décrit dans une lettre en ces termes : « She hath a memory that will hear a sermon and goes home and penn itt after dinner verbatim.» Sir John Leeke to Sir Edmund Verney, August 11, 1638, in Memoirs of the Verney Family, 3 vol., Londres, 1925, I, p. 123, < https://archive.org/details/memoirsofverney01vern/page/122/mode/2up?q=memory> [consulté le 22 aout 2022]
[20] « An eloquent woman is never chaste», cité dans Isotta Nogarola, Complete Writings: Letterbook, Dialogue on Adam and Eve, Orations, trad. Margaret L. King and Diana Robin, Chicago: Chicago University Press, 2004, p. 69
[21] Cité dans Margaret L. King, « Book-Lined Cells: Women and Humanism in the Early Italian Renaissance », in Beyond their Sex: Learned Women of the European Past, Patricia Labalme (ed.), New York, New York University Press, 1980, p. 76, ma traduction.
[22] « Mais vous me demandez à quelles études de lettres la jeune fille devra consacrer son temps. J’entends qu’elle se consacre à l’examen de la sagesse qui induit de bonnes mœurs, qui apprend l’existence et qui enseigne comment vivre en bonne catholique. Elle a moins à faire avec l’éloquence qu’avec la probité et la chasteté. », Jean-Louis VIVÈS, L’éducation de la femme chrétienne, Pierre de Changy (trad.), 2010, Paris, L’Harmattan, p. 77.
[23] « A larger community of like-minded men and women who were interested in ideas », Carol PAL, Republic of Women, Cambridge, Cambridge University Press, 2012. p. 1, ma traduction.
[24] Christopher Hill suggère également que son domicile a pu accueillir régulièrement les réunions de l’Invisible College à la fin des années 1640. Christopher HILL, Milton and the English Revolution, 1977, p. 133.
[25] Mark Greengrass décrit le cercle Hartlib comme un « groupe diversifié et trié sur le volet, composé d’enthousiastes et de candides partageant un intérêt commun pour les progrès techniques et le savoir afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre », ‘Samuel Hartlib (c.1600-1662)’, ODNB, Mark GREENGRASS, ma traduction.
[26] Cet engagement avait été pris par Hartlib, Dury et Comenius dans un pacte signé en mars 1642. Mark GREENGRASS, « Archive Refractions: Hartlib’s Papers and the Workings of an Intelligencer », in Hunter, Boydell and Brewer (eds.), Archives of the Scientific Revolution: The Formation and Exchange of Ideas in Seventeenth-Century Europe, 1998, pp. 35-48, p. 36.
[27] Un grand nombre de livres de recettes nous sont parvenus sous forme manuscrite. Peu d’entre eux furent imprimés. La plupart suivait une présentation identique. A Collection of Medical Recipes, Royal College of Physicians, MS 504, P. 28, manuscript transcrit dans Patricia CRAWFORD et Laura GOWING (dir.), Women’s Worlds in Seventeenth-Century England, London, Routledge, 2000, p. 30.
[28] « Les Lords sont des seigneurs et les dames sont leurs subordonnées », cité dans Lynette HUNTER, « Sisters of the Royal Society: The Circle of Katherine Jones, Lady Ranelagh », in Hunter and Hutton, Women, Science, Medicine, 1500-1700, Mothers and Sisters of the Royal Society, 1997, p. 186, ma traduction.
[29] Lynette HUNTER, op. cit., p. 182.
[30] La publication de nombreux ouvrages dits de « recettes » atteste de l’existence d’une forme de science domestique. Ils démontrent comment les réseaux féminins se sont développés. Voir par exemple, Elizabeth GREY, A choice manual of rare and select secrets in physick and chyrurgery collected and practised by the Right Honorable, the Countesse of Kent, late deceased; as also most exquisite ways of preserving, conserving, candying, &c., Londres, G. D.,1653, et Aletheia TALBOT, Natura Exenterata: Or Nature Unbowelled By the most Exquisite Anatomizers of Her. Wherein are contained, her choicest Secrets digested into Receipts, fitted for the Cure of all sorts of Infirmities, whether Internal or External, Acute or Chronical, that are incident to the Body of Man. Collected and preserved by several Persons of Quality and great Experience in the Art of Medicine, whose names are prefixed to the Book, Londres, H. Twiford, G. Bedell et N. Ekins, 1655.
[31] Lady Ranelagh apprit l’hébreu seule grâce aux deux traités relatifs à son apprentissage publiés par William Robertson. Pour les réformateurs protestants, l’hébreu est la langue dans laquelle Dieu s’est adressé au monde pour la première fois.
[32] « Women interested in science profited from the reforms that derived from the ideas of Jan Amos Comenius, Europe’s foremost educational consultant. », Patricia PHILLIPS, The Scientific Lady: a social history of women’s scientific interests 1520-1918, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1990, p. 30.
[33] Carol PAL, op. cit., p. 127.
[34] « I have and doe take much pains to fit my Spiritt for an other employment, which if the Lord prevent not by calling mee to that formely spoken off, I am fully resolved to take up this. » Dorothy Moore to Katherine Jones, July, 8th, 1643, lettre n° 10, Dorothy MOORE, op. cit., p. 18.
[35] Caroline VAN ECK, « The First Dutch Feminist Track? », in Miriam de Baar and al. (dir.), Choosing the Better Part, Anna Maria van Schurman (1607–1678), New-York, Springer, 1996, p. 45.
[36] Of Education est un essai publié en 1644 par John Milton et qu’il a dédicacé comme suit ‘To Master Samuel Hartlib’. < https://www.dhi.ac.uk/hartlib/view?docset=pamphlets&docname=pam_14> [consulté le 24 Aout 2023]
[37] John Dury fut le précepteur du plus jeune enfant de Charles I.
[38] John DURY, The Reformed School, Londres, [1649?], <http://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A37084.0001.001>, [consulté le 28 septembre 2023], p. 26.
[39] Hartlib rédigea la préface The Reformed School de John Dury, traité manifestement inspiré des écrits de Dorothy Moore.
[40] Dorothy MORE, « Of the Education of Girles », BL Sloane MS 649, fols. 203-05. [c. 1650]. L’essai de Dorothy Moore manuscrit non daté mais probablement rédigé autour des années 1650, s’adresse à une énigmatique « Madame » probablement Lady Ranelagh. Une transcription de l’essai figure dans Dorothy MOORE, op. cit., p. 86-88.
[41] Ibid., ma traduction.
[42] « I do indeed expect a meeting here this afternoon of the two good men you mention, [Mr Wood and Mr Potter] and my brother Boyle, & another ingenious person, in order to the carrying on of that work, further claiming that the education of children was essential to ‘laying the foundation of the Kingdom of Christ’, because ‘it can be laid no rational way, but by timely and good instruction, joined with such discipline and guidance as may accustom children to repeat the good lessons they are taught by the daily obedience & conformity thereunto. » Dorothy MOORE, op. cit., p. 86, n. 150, ma traduction.
[43] Loc. Cit., ma traduction.
[44] Rédigé en 1620, Le Novum Organum possède un second volet qui s’intitule l’Instauratio Magna. Cet ouvrage ambitionne de fournir une nouvelle logique pour la science fondée sur la méthode de l’induction. Michel MALHERBE, « Novum Organum (F. Bacon) », Encyclopædia Universalis, < http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/novum-organum-f-bacon/> [consulté le 11 novembre 2023]
[45] Il semble que Dorothy Moore soit entrée en contact avec Anna Maria von Schurmann en 1640, cette dernière ayant débuté sa réponse de la manière suivante: « I am delighted to have heard about you and your reputation and thank heaven for knowing a lady like yourself. », Anna-Maria van Schurman to Dorothy Moore, August, 8th, 1640, lettre n° 1, Dorothy MOORE, op. cit., p.1.
[46] Dorothy Moore to Katherine Jones, March, 7th, 1643, lettre n° 9, op. cit., p. 15-17.
[47] Maria-Cristina PITASSI, « Un Ministère ecclésial pour les femmes ? Le contexte culturel et théologique d’un échange épistolaire entre Dorothy Moore et André Rivet (1643) », dans Dix-Septième Siècle, Presses Universitaires de France, 2021/4, n°293, p. 342.
[48] Lynette HUNTER, « Civic Rhetoric in England, 1560-1630 » in Ames Lewis (ed.), Sir Thomas Gresham and Gresham College, Aldershot, Ashgate publishing, 1999, p. 91.
[49] « In our sexe I know noe calling [the service of instructing youth] soe powerfull and profitable for the advancement of the Kingdom of Christ in their spirits, and the making of our sex considerable as this. » Dorothy Moore to Katherine Jones, July, 8th, 1643, lettre n° 10, Dorothy MOORE, op. cit., p. 20, ma traduction.
[50] Hans Bots et Francoise Waquet ont défendu l’idée selon laquelle la République des Lettre était essentiellement masculine. Hans BOTS et Françoise WAQUET, La République des Lettres, Paris, Belin, Bruxelles, De Boek, 1997, p. 96-99.
[51] Sarah HUTTON, « Jones, Katherine, Viscountess Ranelagh (1615–1691) » in Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.
[52] [Her name was] « a passport to the highest intellectual circles », Carol PAL, Republic of Women, op. cit., p. 157.
[53] Mary ASTELL, Reflections Upon Marriage, Londres, John Nutt, 1700.
[54] « What I find deplorable (…) looking about the bookshelves again, is that nothing is known about women before the eighteenth century. I have no model in my mind to turn about this way and that. », Virginia WOOLF, A Room of One’s Own N.Y., 1929, p. 46.